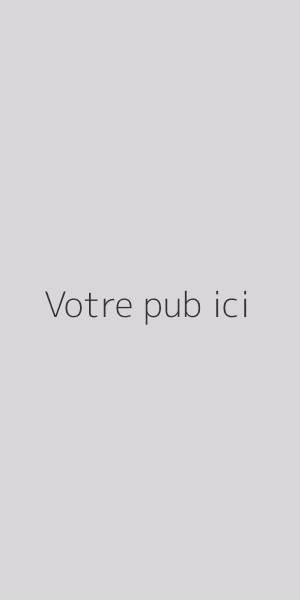Tbourida féminine au Maroc : Les cavalières réinventent la tradition équestre
Partager
Sous un ciel éclatant, au rythme des sabots et au son des salves de baroud, une nouvelle page de l’histoire équestre marocaine s’écrit. La tbourida féminine, autrefois domaine exclusif des hommes, s’impose désormais comme un symbole d’audace, de modernité et de transmission culturelle. À travers ses cavalières, elle incarne une réinvention du patrimoine, où passé et présent s’entrelacent pour offrir un spectacle captivant et porteur d’espoir.
Une tradition revisitée au Moussem Moulay Abdellah Amghar
Lors de l’édition 2025 du Moussem Moulay Abdellah Amghar, les projecteurs se sont braqués sur les troupes féminines de tbourida, qui ont marqué les esprits par leur maîtrise et leur prestance. Trois sorbas féminines ont foulé la piste, rivalisant avec leurs homologues masculins en précision et en éclat. Habillées de tenues traditionnelles soigneusement conçues, ces cavalières ont su allier respect des codes ancestraux et affirmation de leur singularité.
Leur présence, loin d’être une simple curiosité, témoigne d’un engouement croissant pour une discipline qui, tout en restant profondément enracinée dans l’histoire, s’ouvre à des interprétations nouvelles. Les spectateurs, hommes et femmes confondus, se pressent pour admirer ces figures emblématiques d’un Maroc en mutation, où la diversité et l’inclusion prennent une place centrale.
Une émergence lente mais déterminée
L’histoire de la tbourida féminine trouve ses racines au début des années 2000, lorsque des pionnières comme Zahia Abou Layth ont décidé de briser les barrières. Originaire de Doukkala, cette passionnée a fondé une sorba féminine en 2003, affirmant ainsi la légitimité des femmes dans cette discipline exigeante. Son engagement a ouvert la voie à de nombreuses jeunes filles issues des zones rurales et urbaines, désireuses de perpétuer cet art tout en y apportant leur propre empreinte.
Encouragées par des associations et des institutions, les cavalières ont progressivement gagné en visibilité et en reconnaissance. Contrairement aux hommes, elles bénéficient souvent d’une plus grande liberté sur la piste, leur permettant de développer un style plus fluide et expressif. Cette évolution reflète un tournant inclusif dans la société marocaine, où les traditions ne sont plus figées, mais vivantes et adaptables.
La tbourida féminine : entre patrimoine et émancipation
L’inscription de la tbourida au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2021 a marqué une étape cruciale dans la valorisation de cet art ancestral. La montée en puissance des sorbas féminines s’inscrit dans cette dynamique, en réaffirmant l’importance de la transmission intergénérationnelle. Mais au-delà de la préservation du patrimoine, la tbourida féminine porte en elle un message d’émancipation et de résilience.
Pour ces cavalières, le cheval devient un vecteur d’expression et de dépassement de soi. À travers chaque salve de baroud, elles célèbrent non seulement leur habileté technique, mais aussi leur capacité à transcender les barrières sociales et culturelles. Ce spectacle, partagé et relayé sur les réseaux sociaux, attire un public de plus en plus jeune, contribuant à la pérennisation de cet héritage unique.
Une discipline en pleine transformation
Si la féminisation de la tbourida constitue une avancée majeure, elle s’accompagne d’autres évolutions significatives. Les costumes traditionnels, bien que respectueux des codes historiques, intègrent désormais des éléments de modernité, reflétant une esthétique renouvelée. Par ailleurs, l’intérêt accru pour l’art équestre a favorisé l’émergence d’un écosystème dynamique, mêlant élevage, artisanat et tourisme culturel.
Cette transformation s’inscrit également dans une volonté de démocratisation. Les compétitions et démonstrations de tbourida féminine, organisées dans le cadre des moussems et autres festivals, attirent aujourd’hui des familles entières. Elles offrent ainsi une plateforme d’échanges et de rencontres, où le patrimoine marocain devient un point de convergence entre générations et communautés.
L’héritage au galop vers l’avenir
La tbourida féminine n’est pas qu’un phénomène de mode ; elle incarne une vision résolument tournée vers l’avenir. En redéfinissant les contours de cette tradition séculaire, les cavalières marocaines participent à une véritable révolution culturelle, où l’inclusivité et la diversité deviennent des piliers essentiels. À travers leur courage et leur talent, elles réaffirment que le patrimoine est vivant et qu’il appartient à tous.
À chaque galop, chaque éclat de poudre, c’est un appel à l’unité et au partage qui résonne. Ces femmes, fières et audacieuses, rappellent que l’art, sous toutes ses formes, est une source infinie d’inspiration et de résilience. Et dans cette lumière dorée qui éclaire les pistes de tbourida, elles tracent les contours d’un futur où tradition et modernité avancent main dans la main.
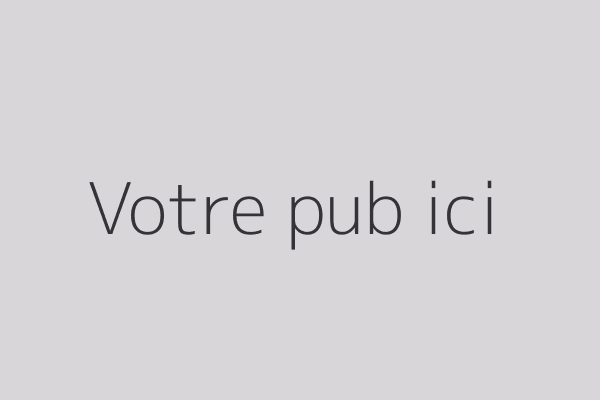
Dernièrs Actualités